André Schwartz-Bar, OVNI littéraire
1959. André Schwartz-Bart devient prix Goncourt avec son roman Le Dernier des Justes. L’auteur est un parfait inconnu du monde des lettres. Sa jeunesse, il l’a passée en Moselle dans une famille où on ne parlait que le yiddish, puis non loin d’Angoulême pour fuir les Allemands. Interdit d’école, il apprendra la vie et le monde dans la rue. Il n’a que douze ans quand ses parents et ses deux frères sont déportés. S’il n’avait pas été dans la rue, il aurait été gazé comme tous les siens. Il a seize ans quand les maquisards le prennent sous leur aile. Arrêté en 1944, il connaitra la torture. On ne peut pas comprendre Le Dernier des Justes, sans évoquer la vie de l’auteur. Comme beaucoup d’adolescents de cette époque, il n’a pas eu de jeunesse.
La parabole des Justes
Ernie Lévy, le héros du roman est un Lamed Wav, un des trente-six tsadik (1) sans lesquels le monde ne pourrait subsister, trente-six âmes qui ne savent pas elles-mêmes qu’elles sont les piliers du monde. Depuis le XIème siècle, l’histoire de la famille Lévy se confond avec celle des Justes, une histoire labourée par les guerres, les épidémies et un antijudaïsme chrétien et, terrible point d’orgue, la Shoah. De génération en génération les Lévy sont des témoins de la fureur des hommes. Ernie Lévy est l’ultime rejeton de cette lignée. Il finira dans les chambres à gaz. André Schwartz-Bart entre parfaitement dans cet hommage que le Contemporain rend aux victimes d’Auschwitz et au 80ème anniversaire de la libération de ce camp on ne peut plus symbolique. À travers la parabole des Justes, l’auteur n’évoque pas uniquement la « question juive » mais s’adresse bel et bien à chacun de nous.
Ernie Lévy ou la résistance contre Dieu
Le lecteur l’imagine personnage simple, aux contours un peu naïf même, mais le trait est trompeur : Ernie Lévy est rebelle. Avec lui la généalogie des Justes semble se gripper. Depuis le XIème siècle la lignée s’est toujours tournée vers une stricte observance religieuse. C’étaient des Justes qui ne se posaient guère de questions existentielles. Ernie, dernier de la liste, ne se révolte pas seulement contre Dieu, mais aussi contre les hommes qui, au final, ne sont pas assez courageux pour lui demander des comptes. « Ô Dieu, quand cesseras-tu d’avoir le regard sur nous, quand nous laisseras-tu le temps d’avaler notre salive ? Seigneur père des hommes, que ne pardonnes-tu notre péché, et que n’oublies-tu notre iniquité ? Un jour tu nous chercheras. » (p. 351) (2) Ernie refuse cette théodicée pour le moins ankylosante qui consiste à voir dans l’épreuve, la quintessence du châtiment divin. Beaucoup de rescapés de la Shoah, religieux avant d’entrer en enfer, allaient en sortir détachés de ce Dieu émasculé de tout sentiment : la Shoah a tout simplement rompu le lien divin. Les questions se sont bousculées, les doutes se sont accumulés. « Pourquoi ? » En résonance de la phrase de Jésus « Pourquoi m’as-tu abandonné ? » Douze ans avant la sortie du Dernier des Justes Primo Lévi dans Si c’est un Homme (3) avait écrit qu’il n’y avait pas de pourquoi. D’autres en revanche, par ce même dédale illogique de la pensée, étaient revenus de la mort avec Dieu comme compagnon, alors qu’ils y étaient entrés convaincus qu’il n’y a avait ni Dieu ni diable.
Le Dernier des Justes, roman dostoïevskien ?
André Schwartz-Bart à la Libération a repris le cours de sa vie et surtout découvert le goût des études. En peu d’années il a comblé ses lacunes et après avoir obtenu une bourse en sa qualité d’ancien Résistant il s’est inscrit en Lettres à la Sorbonne où il découvrit Dostoïevski. Le Dernier des Justes est né sans doute dans sa découverte de l’immense auteur russe. L’œuvre se veut essentiellement une réflexion sur Dieu. Ernie Lévy représente les paradoxes d’une humanité pétrie de paradoxes. C’est un roman sur le passé, le présent, l’avenir. Ernie Lévy, après avoir quitté ses parents, glisse lentement mais sûrement vers un autre monde, celui des « gens qui n’ont pas que Dieu en tête ». Dans leurs pérégrinations la famille Lévy viendra à Paris dans le vieux et insalubre quartier du Marais. Ernie quittera cette famille, mettra le cap au sud, s’engagera d’abord dans un régiment étranger, puis fréquentera des gens à la limite du fréquentable pour finir par se mettre en ménage avec une ancienne prostituée. Le Ernie Lévy de Pologne, d’Allemagne et même du Marais n’existe plus. Le Juif s’est perdu dans le monde des « autres ». C’est un point essentiel de l’œuvre : Ernie en allant dans le « vaste monde des autres » rompt le cordon ombilical qui le lie « culturellement » avec le ghetto. André Schwartz-Bart annonce la couleur pour ainsi dire. Militant sioniste, proche des idées communistes, marié à une écrivaine guadeloupéenne, il ne correspond pas vraiment à l’image du juif religieux et même, si l’on écoute la doxa rabbinique ses enfants ne sont pas juifs. Schwartz-Bart entre en résistance contre ces voix moyenâgeuses. Le sionisme est la seule libération possible, radicale rupture avec le Juif qu’on menait à l’abattoir comme du bétail. Ernie Lévy c’est à la fois André Schwartz-Bart, à la fois les juifs en rébellion contre la pression religieuse, mais aussi les hommes, tous les hommes pour qui le mot liberté s’allie avec résistance. Ce n’est qu’ainsi qu’on comprend l’autre point fort du roman, un Ernie Lévy « ne ressemble pas au Juif tel que le régime de Vichy le montre, avec un nez crochu, des yeux fourbes, un sourire carnassier et des oreilles indécemment développées. Il n’est pas le Jude des affiches allemandes, pas le youpin de la tristement célèbre exposition antisémite française. Il est « comme les autres » et c’est précisément parce qu’il est « comme les autres » qu’il ne sait plus trop bien de quelle racine il puise sa sève. « Si Dieu est en petit morceau, qu’est-ce que ça peut bien signifier d’être juif ? » (p.107)
L’amour… jusqu’au bout du monde des vivants
Pourquoi Ernie finit-il dans une chambre à gaz, lui qui « ne ressemble pas au juif tel qu’on veut qu’il soit » ? Tout simplement par amour. Il a rencontré une fille de son âge (Ernie n’a qu’une vingtaine d’années), une fille qui porte l’étoile jaune. Ensemble, il vont braver le monde en décidant de s’assoir sur un banc de square, lieu formellement interdit par le régime antisémite de Vichy. Mais le destin suit son court : elle est arrêtée. Il la suit sur la route dont il sait qu’elle mène à la mort. Dans le train qui les mène à la cendre, de jeunes enfants à qui il raconte des contes et légendes que la famille a engrangés depuis des générations. Schwartz-Bart nous montre alors un Ernie qui ne cesse de grandir. Etre un juste pour André Schwartz-Bart c’est ne pas avoir peur de douter, mais aussi avoir le courage d’accompagner et surtout d’aimer.
Le Dernier des Justes est à la fois un roman de l’amour autant que de la mort. Un chef d’œuvre œuvre avec Dieu et diable dans les rôles principaux.
Notes
1. Juste en hébreu.

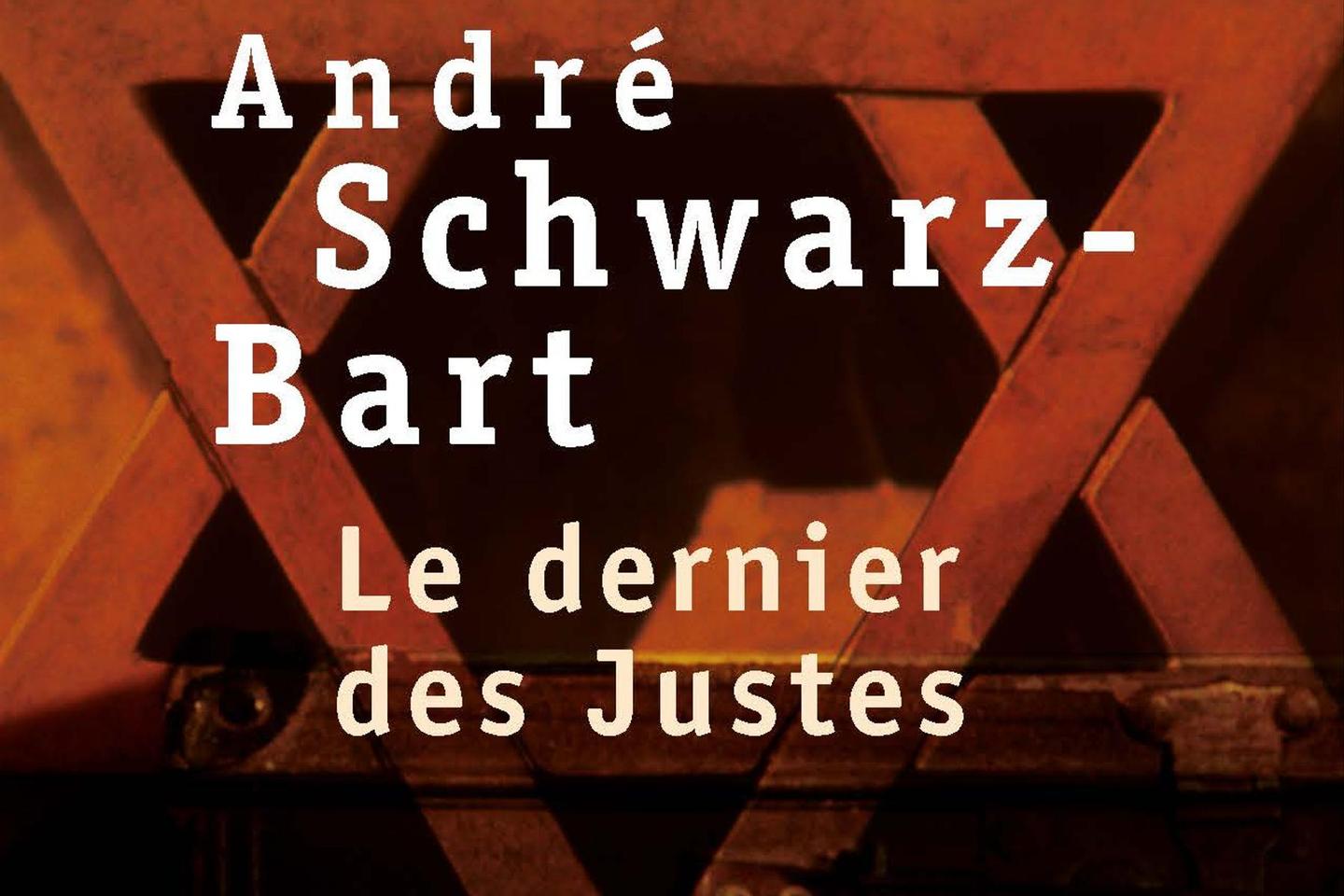
Enregistrer un commentaire